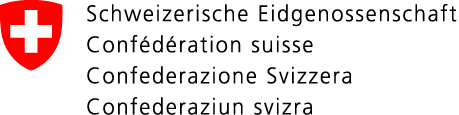Le stockage en couches géologiques profondes sous la surface de la terre est considéré dans le monde entier comme la solution reconnue la plus sûre pour la gestion des déchets radioactifs. La législation suisse prescrit elle aussi un stockage dans un dépôt en profondeur.
En 1999, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a institué le Groupe d’experts pour les modèles de gestion des déchets radioactifs (EKRA), chargé de poser les bases d’une comparaison des différents modèles envisagés de gestion des déchets radioactifs de la Suisse. Dans son rapport de janvier 2000, l’EKRA a conclu que seul le dépôt en couches géologiques profondes peut garantir la protection de l’homme et de l’environnement à long terme. Il a donc développé un modèle de «stockage géologique durable contrôlé» qui associe le stockage final à la possibilité de récupérer les déchets, autrement dit à la réversibilité. Conformément au principe de surveillance, le modèle prévoit notamment une phase d’observation prolongée ainsi que l’exploitation d’un dépôt pilote avant la fermeture du dépôt. Le modèle élaboré par l’EKRA a été inscrit dans la loi sur l’énergie nucléaire.
Un dépôt en couches géologiques profondes est une installation située dans le sous-sol, dans laquelle des déchets radioactifs peuvent être stockés de manière sûre sur le long terme. Il vise à protéger l’homme et l’environnement des risques radiologiques inhérents aux déchets radioactifs sur la durée, sans qu’une intervention humaine ne soit nécessaire à long terme (sécurité passive). Des barrières techniques et naturelles empêchent toute émanation radioactive d’un dépôt en couches géologiques profondes. Lors du stockage, les déchets sont enfermés hermétiquement dans des conteneurs de stockage, qui sont entièrement entourés de matériau de remplissage. Ces deux composantes servent de barrière technique. L’épaisse couche de la roche d’accueil forme la barrière naturelle.
Outre les espaces prévus pour le stockage des déchets, un dépôt en couches géologiques profondes comprend d’autres éléments dans le sous-sol, tels que le dépôt pilote, les zones expérimentales et les infrastructures permettant d’assurer l’exploitation du dépôt jusqu’à sa fermeture. Des infrastructures en surface sont également requises, notamment pour la logistique des déchets, l’approvisionnement et l’élimination, le transport de personnes ou des interventions d’urgence, mais aussi pour l’entretien courant, l’administration et la desserte. Des ouvrages d’accès (des rampes ou des puits) relient les installations de surface aux zones de dépôt dans le sous-sol.
Étant donné que les exigences en matière de dépôt en profondeur et de sécurité diffèrent pour les DFMA et les DHA (par exemple concernant les propriétés des barrières ou la période d’observation), le modèle suisse de gestion des déchets nucléaires prévoit, en concordance avec la pratique internationale, des dépôts séparés pour ces deux catégories de déchets (les DAT, qui ne constituent qu’une part minime des déchets, sont attribuées à l’un des deux types de dépôt). Si la place à disposition et la sécurité le permettent, il est possible de réaliser sur le même site un dépôt en profondeur comprenant deux zones de dépôts séparées pour les DHA et les DFMA (dépôt combiné). La Nagra a déposé une demande d’autorisation générale pour un dépôt combiné sur le site du Nord des Lägern.